Dans son ouvrage La troisième voie du vivant (Odile Jacob, 2022) et Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant (Tracts, Gallimard, 2023), il déplie de façon critique (et non-déprimante) la question du dogme de la performance, dans lequel nous évoluons depuis au moins le Néolithique, et qui a été érigé en modèle absolu par une certaine lecture du darwinisme. Il lui oppose le concept de robustesse dont il a observé la prévalence dans les systèmes vivants, végétaux et animaux. Entre la voie de l’optimisation, du contrôle et de la performance, et celle de la décroissance et de l’effondrement, Olivier Hamant aidé des organismes vivants, trace donc une autre voie : la troisième voie du vivant.

Posons le cadre…
Tentons d’abord de résumer le propos qu’Olivier Hamant élabore.
La performance, c’est la somme de l’efficacité (atteindre son objectif) et de l’efficience (avec le moins de moyens possible). Il s’agit de « faire plus (ou mieux) avec moins ». Ce mode de pensée et de fonctionnement est critiquable à différents égards. Réductionniste dans son appréhension de la situation initiale, il produit une quantité d’autres problèmes qui n’existaient pas au départ. Il est source d’effets rebonds parfois plus délétères que le problème initial. Il devient bien souvent un objectif en soi et perd le sens originel de sa mise en place. Enfin, il a un coût social et écologique considérable : la performance épuise littéralement, les humains, les non-humains et leurs milieux, de la Terre à l’open space…
Notons que la pente d’accélération de ce système de la performance est devenue spectaculaire au moment des deux guerres mondiales qui ont durablement changé notre rapport au monde. On y a augmenté les performances comme jamais auparavant : c’est là qu’on invente à peu près tous les objets modernes qui nous entourent (de l’ordinateur aux engrais, quasi tous ont un lien à la guerre). Or, au sortir de la guerre, on maintient ce même paradigme de la performance. Jamais nous ne sommes revenus en arrière, jamais nous n’avons bloqué cette accélération, comme si un effort de guerre continuait de le justifier.
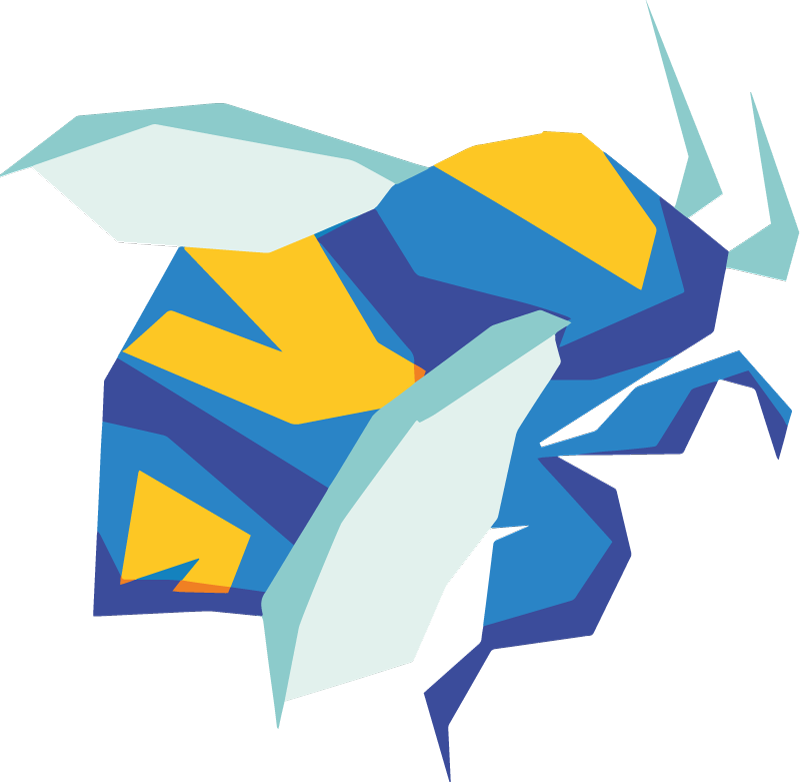
La robustesse est la règle, la performance l’exception.
Olivier Hamant nous fait voir combien dans tous les domaines nous vivons sous l’emprise de ce dogme de la performance : économique et social, professionnel et personnel, éducationnel et même affectif, et c’est aussi le cas avec la transition écologique et le développement durable dont un des grands projets est d’optimiser, de faire de l’efficience et de la performance énergétique (éoliennes géantes, du tout électrique, du tout numérique), au mépris des effets rebonds et d’un véritable questionnement sur nos logiciels de pensée.
Or, le vivant a des choses à nous apprendre… ce qu’en réalité nous savons déjà puisque nous avons utilisé une certaine lecture des travaux de Darwin, y voyant une preuve de la lutte acharnée que le vivant se livre à lui-même à des fins d’adaptabilité et de survie. Cette lecture darwinienne bien partielle (et surtout partiale) a notamment donné lieu au darwinisme social : l’humain en société fonctionnerait lui aussi sur ce mode de la lutte.
Il se trouve, comme on sait, que notre monde largement abîmé par notre mode de vie et de production, se trouve désormais en prise avec la certitude d’une incertitude1 : pénuries de ressources et fluctuations deviennent la règle. Dans un tel contexte, la performance apparaît encore plus obsolète. Il s’agit désormais de faire de la robustesse qui est la réponse opérationnelle pour maintenir le système stable malgré les fluctuations. Cette révolution culturelle repose sur la fin de la volonté de contrôle, de domination et d’exploitation du vivant (y compris humain), la fin d’une posture extractiviste, productiviste, reposant exclusivement sur la compétition.
Comme le logiciel « pseudo-darwinien » de la performance, cette pensée de la robustesse est une pensée bio-inspirée : elle repose sur l’observation rigoureuse du fonctionnement des systèmes vivants qui, incessamment, fonctionnent sur le mode de la robustesse, de la coopération et de la symbiose. Ce qu’il faut comprendre, c’est la dominance de la coopération dans le monde vivant, la lutte existant bien mais comme exception et non comme la règle générale. Cette logique se traduit par exemple dans la relation aux ressources : quand celles-ci abondent, les êtres vivants ont tendance à davantage être dans la compétition. En situation de pénurie, les mêmes espèces basculent plutôt dans la coopération.

Un exemple de notre système biologique : notre température corporelle est de 37°, ce qui, du point de vue du fonctionnement des protéines et enzymes de notre corps, est relativement sous-optimal. Leur niveau de performance est plutôt autour de 40°, ce qu’on nomme la fièvre. Un corps à 40° en biologie, c’est un corps en guerre qui doit combattre un pathogène. Il est alors au maximum de sa performance, notamment son système immunitaire. Mais cela ne peut durer sous peine de s’épuiser et de mourir. Ainsi le corps revient-il à 37°, ce qui est « satisfaisant » et robuste. La robustesse est la règle, la performance l’exception.
En quoi spécifiquement cette pensée bio-inspirée nous intéresse-t-elle aujourd’hui pour tenter d’éclairer les revendications de gens inquiets et parfois démunis quant à notre manière d’habiter la Terre ? Des gens dont beaucoup se trouvent déjà dans une situation de privation…
Une psychanalyste, Anabelle Gugnon, explique qu’en gros le monde est fini, on a atteint, et dépassé, les limites planétaires. Il s’agit de créer un autre infini, parce qu’il n’y a que lui qui mobilise, donne l’envie de continuer, mette les gens en mouvement et crée du lien. Dire que le monde est fini ou que tout va s’effondrer, ça ne marche pas, ça ne mobilise pas (surtout quand on est pauvre et qu’on ne connaît que trop bien la privation). C’est notamment le discours de la sobriété et de l’écologie punitive. Ce que je crois, c’est que cette idée de robustesse, avec d’autres, elle peut créer du désir, elle ouvre un espace d’action en répondant à une pulsion primaire : l’envie de durer et l’envie de transmettre. La sobriété est quant à elle un moyen certes radical mais à cet égard inéquitable, tout le monde ne peut être radical. Mais la subtilité, c’est qu’en faisant de la robustesse, on produit de la sobriété. En outre, avec la sobriété, on pourrait retomber dans un logiciel de performance, tandis que la robustesse est un moyen qui ne peut être optimisé ou radicalisé, ce serait contradictoire.
En fait, la robustesse, une fois qu’on a compris comment elle fonctionne, elle devient une méthode, une pratique, un rapport au monde. Et, outre le fait qu’elle répond à un désir de pérennité, elle est basée sur la richesse des interactions qui se trouvent densifiées et diversifiées, parce qu’il n’y a que comme ça que fonctionne la robustesse. Ainsi quitte-t-on le monde de la pauvreté des interactions. Il n’y aura pas grand-chose à regretter.
Vous nous donnez des exemples ?
Prenons la mobilité avec un trajet d’un point A à un point B : si on réside dans la performance, on va chercher à optimiser son trajet en fonction de la distance et du temps dans l’idée de faire au plus vite et au plus court, idéalement les deux. Dans le monde de la robustesse, il s’agira plutôt de se demander quelle est l’épaisseur du trajet ? De A à B, il existe une quantité de trajets possibles, c’est l’épaisseur du trajet. Cela signifie qu’il y a plein d’alternatives qui pourront être mobilisées, utilisées : on va y rencontrer des gens au hasard, y compléter quelque chose, potentiellement ça prendra plus de temps mais ça sera plus riche aussi. Ce sera robuste. Ainsi réactive-t-on d’autres chemins et le jour où le chemin le plus court n’est pas disponible, on sait qu’il existe des alternatives déjà manipulées. C’est vraiment une autre manière de penser, de la longueur à l’épaisseur.
De même avec l’école : arrêtons l’école de la compétition avec ses notes, etc. Il existe d’ailleurs déjà des écoles avec des pédagogies alternatives qui reposent sur la transmission, l’entraide et la coopération, et qui permettent d’élaborer ensemble des savoirs plus robustes, davantage construits sur le sens et non plus sur la performance, la « réussite » ou l’excellence. Ça ne veut pas dire qu’à certains moments, il ne faut pas se donner à fond et produire un effort intense pour intégrer une connaissance, un savoir. Mais c’est comme pour l’exemple de la fièvre que je citais plus haut, ça ne doit pas être la règle absolue. De même dans le monde de l’entreprise, le modèle de la coopérative, c’est la robustesse du groupe.

Ce paradigme performance/robustesse fonctionne aussi au niveau politique
Un objet robuste, c’est un objet polyvalent et le contraire d’un objet performant. Avec un ciseau à pizza, objet certes performant, que pouvez-vous faire à part… couper des pizzas ? Mais s’il n’y a pas de pizza ? Eh bien rien. Un couteau en revanche, ou une cuillère, voilà des objets particulièrement robustes ! (et moins impactant en termes de fabrication)
Il y a mille idées dans tous les domaines quand on prend la peine d’y penser, qui sont d’autant plus géniales qu’elles sont simples. Et ça, ça peut donner envie.
Il y a un peu l’idée de composer avec (les aléas, les contraintes, etc) plutôt que de lutter contre ?
Tout à fait. Un autre exemple dans le domaine de l’architecture qui va dans ce sens : l’architecte Patrick Bouchain travaille sur l’architecture du déjà-là. Plutôt que de raser des quartiers ou des habitations pour produire un grand geste architectural, il travaille avec les habitants en leur demandant comment ils vivent et comment ils verraient leur habitat à cet endroit-là, et ils avancent ainsi ensemble. Il arrive d’ailleurs que son intervention ne se voit pas ou à peine. Cette méthode a beaucoup moins d’impact écologique et est plus robuste, y compris socialement parce que c’est réalisé avec, et du coup accepté par, les populations.
On imagine bien qu’il y a des freins…
Je crois vraiment que c’est culturel. Il faut parvenir à faire la déprise, c’est-à-dire se défaire de l’emprise de la performance qui nous tient de façon tenace. Le principal frein réside sans doute dans ce changement des mentalités (et je m’inclus dans cette boucle, bien sûr). Les moments d’arrêt aident en général, on l’a vu avec le Covid qui aura au moins eu cet intérêt-là.
Dans les entreprises, il s’agit de nourrir la polyvalence. Ça peut être bien d’être spécialistes en quelque chose à un moment de la journée mais l’être en permanence induit une forme de pauvreté. Et les institutions sont faites sur un fonctionnement en silos. Je dois dire que je rencontre beaucoup de gens du monde de l’entreprise (à leur demande), chose à laquelle je ne m’attendais pas spécialement, qui, depuis la crise sanitaire, sociale (notamment les gilets jaunes), énergétique, géopolitique, m’écoutent beaucoup plus sérieusement. Ce que l’on savait théoriquement auparavant, sur la pénurie des ressources notamment et les fluctuations de prix, est devenu chose concrète pour beaucoup de gens, particulièrement dans certains domaines d’activités. C’est évidemment le cas dans la construction. Et ceux qui ont été formés à la compétition se retrouvent à coopérer avec leurs compétiteurs directs. On abandonne le principe de concurrence libre et non faussée, l’entente devient de l’entraide.

Il y a deux niveaux où ceci dit ça me semble coincer davantage. D’une part, dans le monde de la finance qui a fort peu intérêt à la robustesse. D’autre part au niveau politique, bien que de façon moins marquée au niveau local et territorial où l’on est plus directement impactés et conscients des fluctuations. Par exemple, c’est le cas à Lyon. La Wallonie s’est quant à elle déclarée « Une Wallonie robuste » au niveau du ministère de l’Environnement (après un de mes entretiens sur La Première-RTBF, m’a-t-on dit). Il est par exemple dommage qu’avec la Convention climat, Emmanuel Macron, qui se trouve être Président dans un moment assez extraordinaire de bifurcation de l’Histoire, soit resté scotché à son logiciel de performance et de la haute finance et n’ait pas saisi cette opportunité d’entrer dans l’Histoire en prenant à bras le corps les 149 propositions émises par 150 citoyens, tirés au sort, « non-experts », comprenant même des climatosceptiques, mais qui ont produit de la légitimité et élaboré des propositions plus ambitieuses que ce que des experts ou des députés auraient pu émettre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, ce fonctionnement et ces propositions ont produit de la robustesse (et de la puissance) d’un point de vue démocratique. C’est très intéressant de remarquer que ce paradigme performance/robustesse fonctionne aussi au niveau politique.
Une proposition politique concrète ?
Commençons par le plus simple sans doute : les objets. On a, par exemple, un indice de réparabilité en France. Or, un objet réparable est un objet robuste. C’est la réponse opérationnelle à l’obsolescence programmée. Un gobelet en plastique jetable ça n’est plus possible. Il faut mettre un bonus-malus à ce genre de produits, les rendre plus chers (ce qui permet en plus d’avoir un impact sur la dimension économique et évite de produire une écologie pour les riches). Ce critère peut être combiné au critère local qui peut encore faire baisser le coût du produit. C’est simple et à budget constant. En Europe, on a largement assez d’argent pour faire la transition écologique, c’est juste qu’on n’a pas encore fait le tri dans les solutions. Premier critère : la robustesse !