
Nous avons interrogé avec elle le traitement réservé par les tribunaux aux actes de sabotage ou de désobéissance civile, et réfléchi de façon plus générale à la justice comme possible contre-pouvoir, à la justice et à son sens du juste…
Marie Jadoul est doctorante au Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité à l’UCL. Elle a débuté une recherche doctorale qui a pour vocation de croiser les notions de désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique, de liberté d’expression et d’état de nécessité en droit pénal. S’il est donc principalement question de désobéissance civile dans ses recherches, la frontière est assez ténue avec celle du sabotage qui est parfois revendiqué par une partie des activistes écologistes, en marge des actions de désobéissance civile.
Quelle est l’approche générale du droit vis-à-vis de la désobéissance civile ou éventuellement du sabotage ?
Je dirais d’abord que pour le droit, la désobéissance civile est un « objet juridique non-identifié »1 qui sort complètement des cases et des catégories prévues par le droit. Ainsi, pour pouvoir s’accorder autour d’une définition de la désobéissance civile qui a du sens, on doit s’orienter vers d’autres disciplines (philosophie politique, sociologie des mobilisations, théorie politique, etc.). L’appartenance à une catégorie juridique ou l’existence d’une définition est bien souvent synonyme d’existence dans le champ juridique. Il y a en outre toute une série de nuances à prendre aussi en compte, comme celle entre désobéissance civile directe (quand on viole directement la loi qu’on conteste, comme Rosa Parks par exemple) et désobéissance civile indirecte (quand on viole une autre loi que celle qu’on conteste). Cette nuance a son importance dans certains systèmes juridiques, comme dans les systèmes de common law (UK ou USA) où, pour les actes de désobéissance civile indirecte, les activistes n’ont pas la possibilité de présenter tous les moyens de défense.
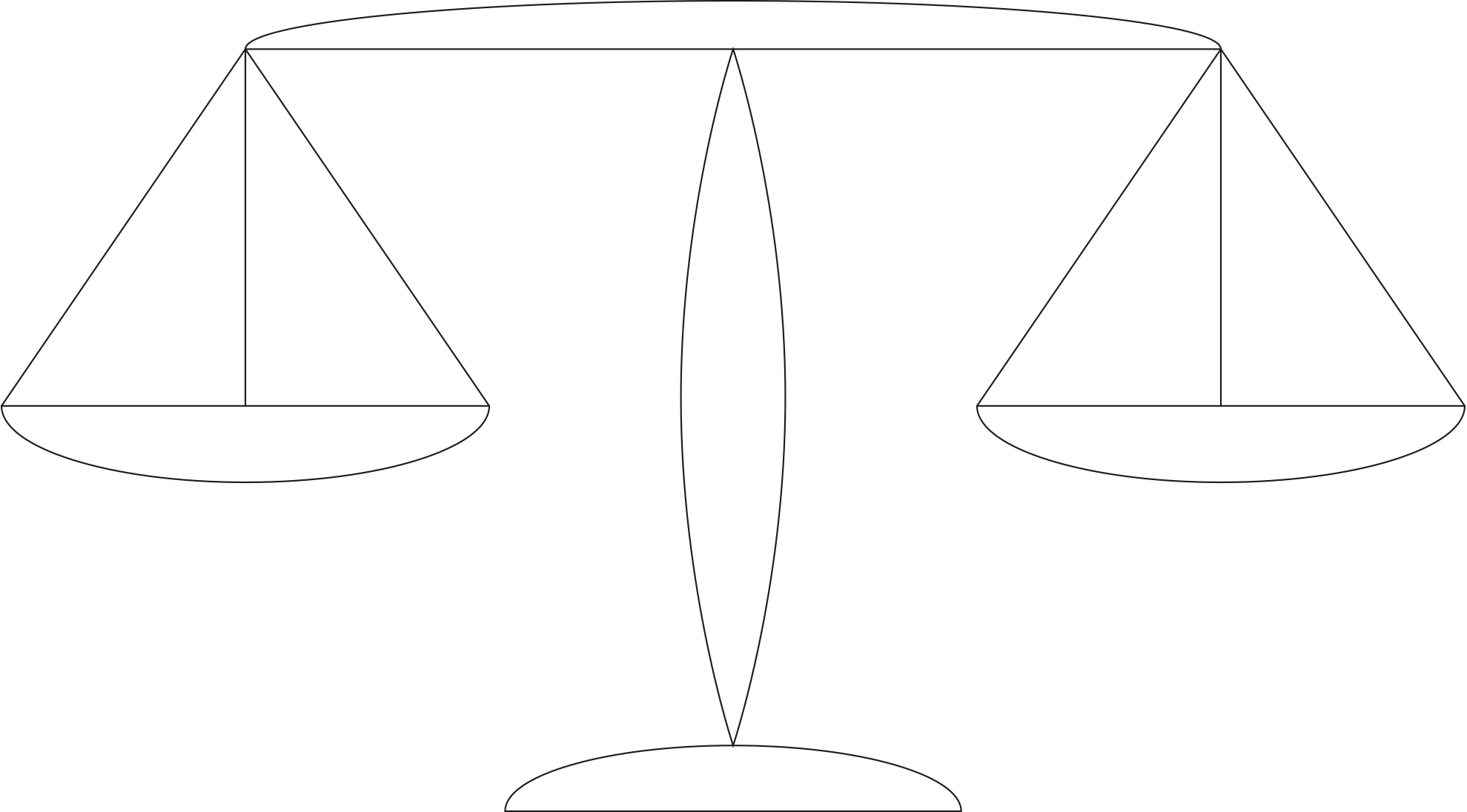
Ces premiers éléments posés, il faut savoir qu’en Belgique, les dossiers relatifs à la désobéissance civile sont noyés parmi les dossiers de droit commun qui sont traités par les sections générales des tribunaux correctionnels (traitant par exemple des vols, des stupéfiants, de tout ce qui concerne les dégradations matérielles, des coups et blessures, etc.). Cela peut avoir des conséquences en termes de jugement : soit les actes de désobéissance civile seront considérés par les juges comme des actes de droit commun, soit ils seront considérés comme une forme aggravée « de délinquance politique » s’affranchissant des contraintes de la loi2. On est donc sur une ligne de crête. Mais dans les deux cas, on peut sans doute déplorer le fait que les aspects citoyens et démocratiques des actes ne sont que peu ou pas pris en compte. Que les actes soient illégaux, c’est une chose puisqu’ils transgressent la loi, mais est-ce qu’ils sont pour autant illicites au sens d’illégitimes ?
Peut-on dire qu’on assiste actuellement à une multiplication d’affaires et de procès pour désobéissance civile ?
Je pense qu’il y a une intensification et une diversification des actions de désobéissance civile. On assiste à une forme de réémergence de ce mode d’action, et sans doute plus particulièrement en matière écologique, depuis 2018 dans la suite des grèves mondiales pour le climat, Friday for Future, Youth for Climate, en parallèle de toute une série d’épisodes météorologiques extrêmes qui ont pris place en Belgique et ailleurs dans le monde. Mais pour autant, en Belgique, on n’observe pas une multiplication des procès liés à des affaires de désobéissance civile environnementale comme c’est le cas en France et en Suisse. On peut dégager plusieurs pistes d’explications à cela. Sans doute y a-t-il déjà le filtre de l’opportunité des poursuites : c’est le parquet qui choisit de poursuivre ou non certains actes/faits commis. Il faut savoir que dans tous les dossiers et plaintes qui sont déposées en Belgique chaque année, environ 90% sont classées sans suite, au regard, notamment, des priorités définies par la politique criminelle. En effet, de façon périodique, le Collège des procureurs généraux se positionne et donne des avis au ministre de la Justice pour définir les priorités liées au contexte et à l’évolution de la criminalité. Autre hypothèse, mais qui est plutôt de l’ordre de l’intuition que vérifiée scientifiquement à ce stade, on connaît, en Belgique, une certaine culture de la négociation, en ce compris dans l’espace public. Une approche davantage négociée de l’espace public3 – par opposition à la France ou à la Suisse où une gestion plus rigide et « confrontationnelle » est mise en œuvre. Une activiste de Liège me disait ainsi au sujet des mobilisations contre l’extension de l’aéroport de Bierset à Liège (« Stop Alibaba »), que les activistes avaient pu discuter avec la police. Enfin, on pourrait aussi imaginer que le refus du parquet de poursuivre certaines affaires participe d’un refus de publiciser ce type de procès en Belgique, puisque les procès permettent aussi de médiatiser une question politique. C’est une question que j’aimerais explorer dans le cadre de ma thèse.

Quels sont les motifs d’accusation généralement avancés à l’encontre des prévenus et quels types de risques encourent-ils ?
Je vous propose d’évoquer succinctement quelques affaires de désobéissance civile ayant trait au contexte de crise environnementale. À titre d’exemples, les motifs d’accusation suivants ont été retenus :
- Dans l’affaire relative à l’arrachage de plants d’OGM à Wetteren en mai 2011, on reprochait aux onze prévenus (sur plusieurs centaines de participants) la destruction et la détérioration de denrées, de marchandises et autres propriétés mobilières. Ils étaient également accusés d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés. Ce qui a finalement été retenu contre eux est la destruction malveillante de fruits des champs, de clôtures rurales, ainsi que des actes de rébellion et de coups et blessures commis contre les policiers.
- En 2016, dans le cadre de l’action « TTIP Game Over », un activiste est parvenu à diffuser une autre vidéo que celle relative à la publicité diffusée sur le grand écran digital Coca-Cola de la place De Brouckère à Bruxelles. Il a été accusé d’intrusion informatique externe, de sabotage informatique et de destruction volontaire de la propriété mobilière d’autrui. Suite à sa comparution, il a obtenu une suspension du prononcé de la condamnation, qui est une mesure de faveur octroyée par le tribunal. Ainsi, le seul fait de devoir comparaître devant le tribunal et d’obtenir cette suspension du prononcé (avec, le cas échéant un délai d’épreuve) est considéré comme une peine suffisante pour le justiciable.
- En mai 2017, plusieurs personnes déguisées en animaux et végétaux et faisant partie du collectif de l’EZLN-Ensemble zoologique de Libération de la Nature ont notamment dénoncé l’implication de la société ECPA dans la crise écologique. Les motifs retenus contre les prévenus ont été des dégradations mobilières et immobilières et des graffitis.
- Enfin, en 2019, à Liège, trois militants du GRACQ avaient marqué sur le sol une nouvelle piste cyclable. Ils ont d’abord été poursuivis pour entrave méchante à la circulation. Ils ont également été accusés de destruction de monuments. Finalement après les avoir entendus, le tribunal a requalifié l’accusation en dégradation matérielle.
On pourrait imaginer que le refus du parquet de poursuivre certaines affaires participe d’un refus de publiciser certaines questions politiques
Ces quelques affaires mettent en évidence le fait que les risques auxquels les activistes s’exposent potentiellement sont multiples : il peut y avoir une sanction administrative communale (SAC), des risques de poursuites pénales, avec un casier judiciaire, l’indemnisation des victimes si elles en font la demande, et puis le fait de devoir supporter les frais de justice qui sont parfois extrêmement élevés, voire de faire l’objet dans certains pays comme en France d’une surveillance particulière des forces de l’ordre ou de mesures d’exception. Dans certains cas, cela peut aller jusqu’à la perte d’emploi. Il y a aussi les risques civils : si le parquet décide de ne pas poursuivre, le plaignant peut, d’une part, se constituer partie civile entre les mains du juge d’instruction ou, d’autre part, introduire une action au civil devant le Tribunal de première instance mettant en cause l’auteur des faits, et demander réparation. Enfin, il existe aussi des risques moins visibles, et parfois plus insidieux, qui vont notamment toucher certaines catégories de personnes déjà fragilisées, comme les personnes étrangères ou racisées qui seront davantage impactées au contact des forces de l’ordre ou dans leur accès aux droits, alors pourtant que la loi est la même pour tous4.
Mais, au-delà des actes illégaux, la justice tient-elle compte des intentions et buts poursuivis par les activistes ? Cela infléchit-il les jugements ?
Quand on commet un acte de désobéissance civile, cela n’est pas pour soi-même, dans un but égoïste, au contraire par exemple du trafiquant de drogue, il y a bien une valeur plus haute qui est défendue. La justice tiendra sans doute compte de cela dans certains cas. Elle a en tout cas la possibilité de le faire de deux manières. D’une part, elle peut considérer qu’il y a une cause de justification, par exemple en admettant l’« état de nécessité ». Une cause de justification est un ensemble de circonstances qui vont être invoquées par la personne qui comparaît et qui ont pour effet de supprimer le caractère illicite du comportement reproché.
Il y a une forme de caractère ambivalent du droit : tantôt il est « complice de la domination et de la répression », tantôt, il peut être le vecteur de davantage de protection, de contestation, de transformation sociale
Ensuite, le juge peut également admettre des circonstances atténuantes qui auront pour effet de réduire la peine à laquelle est soumis un justiciable. Les jugements admettent cela et les mentionnent parfois de façon tout à fait explicites (jeune âge du prévenu, pas d’atteinte aux personnes, contexte de l’action, action et buts désintéressés, etc.). Je rappelle à cet égard l’individualisation de la peine, principe essentiel en droit pénal. Les magistrats peuvent adapter (sans y être contraints) la sanction judiciaire en s’appuyant sur différents éléments : la personnalité du justiciable, le milieu social, l’âge, la vie professionnelle et privée, l’état psychologique. Par exemple, dans une affaire de désobéissance civile environnementale en Suisse, l’état d’anxiété du justiciable a été pris en compte dans le contexte de l’urgence écologique qui l’a poussé à commettre l’action. Cette éco-anxiété revient souvent dans les tribunaux suisses et français, parfois en étant objectivée par des témoignages (si le juge accepte un tel témoignage) ou le dépôt de divers documents (documents médicaux, rapports d’experts et scientifiques, etc.). On peut ainsi observer que des peines très différentes sont prises par des juges différents pour le même type d’actes. Mais cela reflète une fracture beaucoup plus globale qui se matérialise déjà dans nos sociétés, une forme de division de la société face aux grands enjeux environnementaux notamment, et aux mesures à mettre en œuvre face à ceux-ci.
Peut-on revenir à cette notion d’état de nécessité sur laquelle vous travaillez et qui est régulièrement mobilisée pour la défense des activistes ?
L’état de nécessité est une cause de justification (permettant d’acquitter la personne qui démontre que certaines conditions sont réunies) qui s’est progressivement forgée et complexifiée au fil de la jurisprudence. Il peut être invoqué suivant certaines conditions5. Le prévenu doit pouvoir démontrer au moment des faits, qu’il se trouvait dans une situation de danger grave, certain, actuel ou imminent, pour soi-même ou autrui, ou à l’encontre de biens, danger qui le plaçait devant un conflit d’intérêts : respecter la loi pénale et l’ordre public qu’elle définit ou, au contraire, commettre une ou plusieurs infraction(s) pour préserver un autre droit ou intérêt considéré comme supérieur, en acceptant de se soumettre à un contrôle postérieur des cours et tribunaux. En effet, il faut pouvoir démontrer que l’intérêt défendu est plus important que celui qui est sacrifié (principe de proportionnalité). L’individu doit également démontrer qu’il ne pouvait sauvegarder la valeur menacée autrement qu’en commettant l’infraction (principe de subsidiarité). Enfin, il faut démontrer qu’aucune faute préalable à l’acte délictueux n’a été commise.
L’état de nécessité a beaucoup été utilisé en Belgique pour défendre les résistants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont ainsi pu être acquittés pour des faits qui, en temps normal, leur auraient valu une condamnation.
Ainsi, dans les cas de désobéissance civile commise dans le contexte de l’urgence écologique, les juges pénaux sont confrontés à la question de savoir si les dérèglements climatiques qu’on connait aujourd’hui constituent un danger grave, actuel ou imminent, si les activistes auraient pu protéger la planète et la vie sur la planète autrement qu’en commettant l’infraction qui leur est reprochée, et si la situation dans laquelle ils se sont placés procède ou non d’une faute préalable de leur part. Les deux points d’attention majeurs sont, la plupart du temps, les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’enjeu est évidemment de taille puisque si l’individu inquiété peut démontrer d’un état de nécessité justifiant la commission de l’infraction qui lui est reprochée, il en sera acquitté par le juge.
Mentionnons que l’état de nécessité a beaucoup été utilisé en Belgique pour défendre les résistants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont ainsi pu être acquittés pour des faits qui, en temps normal, leur auraient valu une condamnation. Le professeur de droit pénal P-E Trousse a dit en 1956, concernant l’état de nécessité qu’il « offre quelque analogie avec le phénomène qu’en spéléologie on appelle la résurgence. En effet, cette notion va et disparaît pour réapparaître à certains moments de la pensée juridique avec une force accrue. Il est curieux de constater qu’elle trouve un regain de faveur lorsqu’il s’agit de résoudre théoriquement des situations de crise tant, dans la vie des individus que dans la vie des collectivités. […] elle est invoquée dans des périodes de guerre ou de cataclysmes pour justifier des solutions qui s’accommodent mal de la rigidité naturelle de la législation pénale6 ».
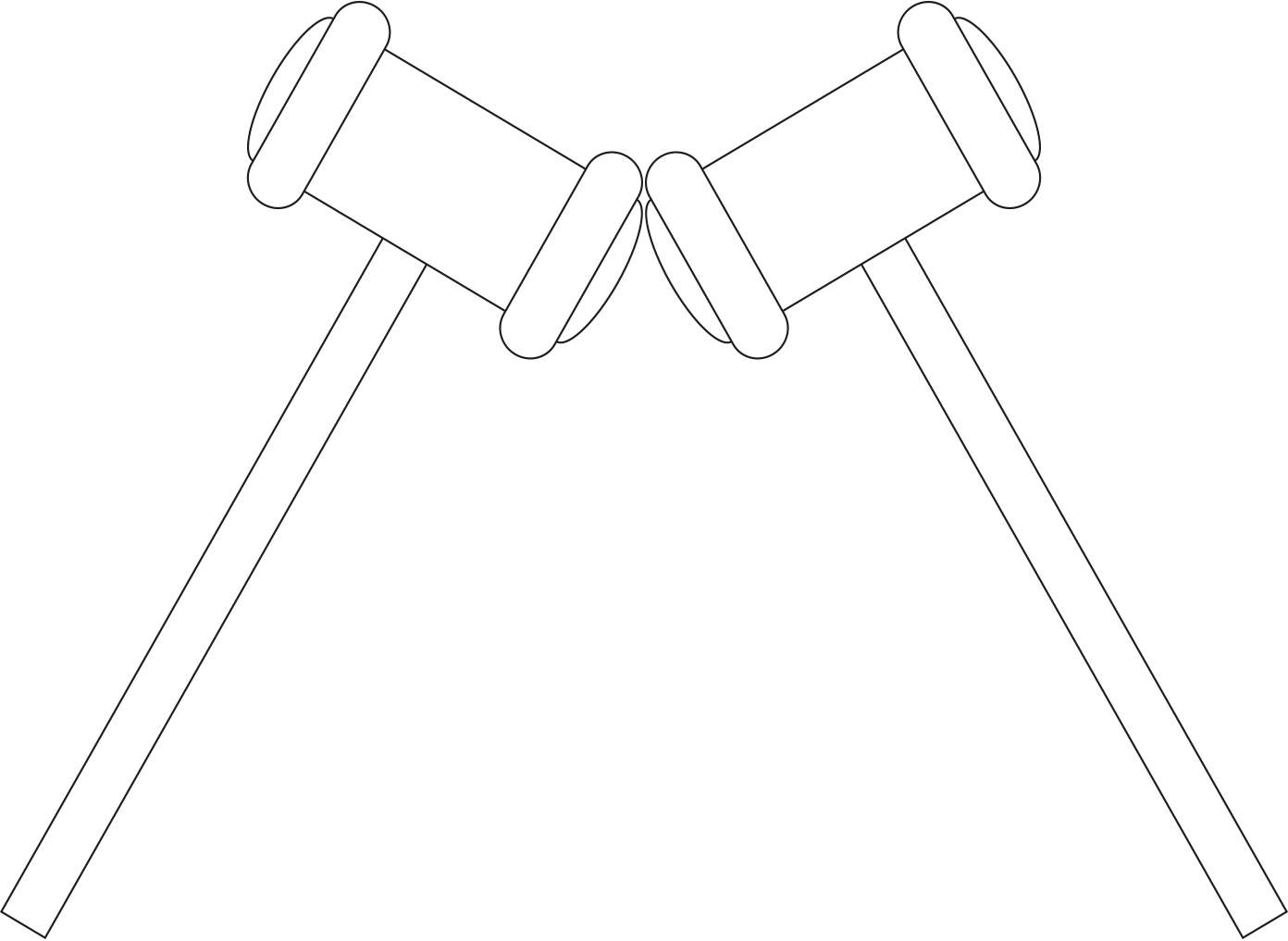
Cette problématique pose aussi la question des nuisances et de comment la balance de la justice s’équilibre sur celle-ci : les nuisances opérées par le prévenu et celles opérées par le plaignant, qui souvent touchent une population conséquente voire entière (spécifiquement sur les questions environnementales mais aussi économiques et sociales) ?
Cette question des nuisances est intéressante, mais il m’est difficile d’y répondre à ce stade. Il y a une forme de bipolarité, de caractère ambivalent du droit. Tantôt il est « complice de la domination et de la répression », tantôt, sous certaines conditions, il peut être le vecteur de davantage de protection, de contestation, de transformation sociale. Qu’est-ce que ces procès ont eu comme effets ou comme impacts, et peut-on considérer à ce stade que la Justice constitue une certaine forme de contre-pouvoir ? Clémence Demay avance dans sa thèse qu’on peut retenir la désobéissance civile comme exerçant un contrôle de constitutionnalité et que cela s’inscrit au rang des mécanismes de contre-pouvoir présents au sein d’une démocratie constitutionnelle. Ainsi dit-elle que « loin d’être une tyrannie de la minorité, les actes de désobéissance civile sont présentés en philosophie comme une manière de contribuer à un espace de débat et de faire la place à des revendications, des changements souhaités par une partie de la population qui ne peut l’exprimer qu’avec ses moyens. Cette mesure constitue un contre-poids, un contre-pouvoir en complément à la règle majoritaire. »
«Loin d’être une tyrannie de la minorité, les actes de désobéissance civile sont (…) une manière de contribuer à un espace de débat et de faire la place à des changements (…) souhaités par une partie de la population.»
Cela pose aussi la question de la conception du rôle des avocats d’une part, et des juges, d’autre part, qui, selon la typologie de François Ost, agissent comme des juges-entraîneurs, c’est-à-dire usant d’un « instrumentalisme dynamique » à l’égard de l’état de nécessité et de la liberté d’expression qu’ils vont éventuellement mobiliser en tant qu’arguments juridiques. Dans un tel modèle, le juge n’est plus « l’applicateur passif de principes et de règles préétablis » (vision légaliste et étroite du rôle et de la position du magistrat), mais il « collabore à la mise en œuvre de finalités sociales et politiques » où « une grande attention est portée aux éléments de fait, matériels et psychologiques de l’affaire. À cette fin sont mobilisées toutes les ressources de l’enquête empirique7 », en permettant les témoignages de toute une série de personnes devant la Justice. Cela pousse à développer une conception beaucoup plus exigeante de la fonction et du rôle des juges.